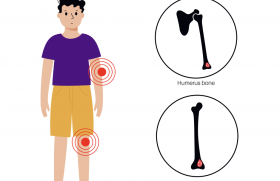Publié le 10 déc 2012Lecture 25 min
Reconnaître et traiter un accès palustre chez l'enfant : conduite à tenir dans le cadre du paludisme d’importation
L. PULL*, E. KENJO**, O. BOUCHAUD***, J.-Y. SIRIEZ* *Service des urgences, Hôpital Robert-Debré, Paris **Centre national de référence du paludisme, Paris ***Service des maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Avicenne, Bobigny

Le nombre de cas de paludisme d’importation déclarés par le Centre national de référence du paludisme en France est en augmentation. Quatorze pour cent des cas concernent des enfants de moins de 15 ans. L’hôpital Robert-Debré (Paris) est un des principaux centres en France à prendre en charge les enfants voyageurs et gère la plus importante cohorte d'enfants impaludés en Europe. Le paludisme reste, en 2012, un problème...
Le paludisme reste, en 2012, un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale et la maladie parasitaire la plus répandue à la surface du globe. Dû à cinq espèces de parasite (Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae et P. knowlesi), le paludisme est transmis à l’homme par la piqûre de moustiques femelles infectées appartenant à l’espèce anophèle. Épidémiologie Situation épidémiologique dans le monde En 2010, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 3,3 milliards d’individus étaient exposés au risque de contracter un paludisme(1) ; 81 % des 216 millions de cas alors estimés et 91 % des décès (estimés à 655 000) sont survenus en Afrique subsaharienne, affectant principalement les enfants de moins de 5 ans (86 % des décès) et les femmes enceintes. Les sommes nécessaires à la lutte antipaludique, estimées à plus de 5 milliards de dollars par an pour la période 2010-2015, se sont élevées à 2 milliards de dollars en 2011. Ces financements ont permis, par exemple, de faire passer le pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée (MI) en Afrique subsaharienne de 3 % en 2000 à 50 % en 2011. Le renouvellement des moustiquaires constitue un important défi pour l’avenir. La durée de vie d’une moustiquaire imprégnée d’insecticide longue durée est en effet estimée à 3 ans ; les moustiquaires distribuées en 2007 et 2008 doivent donc être remplacées, ainsi que toutes celles, nombreuses, qui ont pu être abîmées ou trouées. En outre, une résistance aux pyréthroïdes, seuls composés servant à imprégner les moustiquaires, a été observée dans 27 pays d’Afrique subsaharienne. Le moment où l’efficacité de la lutte antivectorielle s’en trouvera affectée reste incertain et risque de varier en fonction du mécanisme de résistance identifié à l’échelle locale. Enfin, une moustiquaire, fût-elle imprégnée correctement et en très bon état, ne sera efficace que si l’enfant est protégé par elle au moment où les anophèles sont en quête de protéines, après le coucher du soleil, ce qui est loin d’être toujours le cas. Il est actuellement recommandé par l’OMS de procéder à une confirmation parasitologique rapide du diagnostic, par examen microscopique ou par un test de diagnostic rapide (TDR), avant de prescrire un traitement à un patient suspect d’infection palustre. Le nombre des TDR fournis par les fabricants est passé de 45 millions en 2008 à 88 millions en 2010, et la qualité de ces produits s’est considérablement améliorée. Dans les pays où le paludisme sévit à l’état endémique, les cas confirmés de paludisme simple à P. falciparum doivent, selon l’OMS, être traités au moyen d’un dérivé de l’artémisinine combiné à une autre molécule. En 2010, 84 pays et territoires ont adopté ce type de traitement en première intention. Toutefois, dans la région Afrique, le nombre de traitements distribués en 2010 a été plus de deux fois supérieur au nombre total de tests (examens microscopiques et TDR) effectués, ce qui signifie que de nombreux patients se voient encore prescrire des traitements sans confirmation préalable du diagnostic. Par ailleurs, la plupart des pays qui autorisent encore la commercialisation des monothérapies à base d’artémisinine se trouvent dans la région Afrique. Ces attitudes peuvent favoriser l’apparition de résistances, de même qu’une mauvaise compliance à un traitement qui doit être pris pendant 3 jours. Situation épidémiologique en France En 2010, 2 438 cas de paludisme d’importation ont été déclarés par le Centre national de référence du paludisme en France, soit une augmentation de 10,8 % par rapport aux cas déclarés en 2009, alors que la tendance évolutive du nombre de voyageurs vers les zones d’endémie semble orientée à la baisse depuis 2009(2). Figure 1. Répartition des cas pour les 17 pays de contamination présumée les plus fréquemment rencontrés chez les enfants ( < 15 ans) (année 2010, n = 329). Le nombre de cas estimé est de 4 640 pour l’année 2010, soit une variation de + 12,1 % par rapport à 2009. Environ 14 % des cas de paludisme survenus en France en 2010 concernent des enfants de moins de 15 ans, dont l’âge moyen est de 7 ± 4 ans. La proportion des nourrissons dans la population totale est de 2,1 %, celle des enfants (3-14 ans) est de 11,7 %. Les pays dont proviennent le plus grand nombre de cas pédiatriques étaient, en 2010, la Côte d’Ivoire, les Comores, le Cameroun et le Mali (figure 1). Le pic de fréquence se situe entre juillet et septembre. L’espèce plasmodiale la plus fréquemment renrencontrée est Plasmodium falciparum (figure 2) et il s’agit dans la grande majorité des cas d’accès simples, avec ou sans vomissements. Figure 2. Paludisme importé en 2010 : distribution annuelle des cas par espèces. Physiopathologie Le paludisme est une maladie parasitaire du sang transmise par un moustique qui s’exprime principalement par de la fièvre et qui peut être mortelle. La transmission ne se fait que dans certaines zones tropicales (90 % en Afrique subsaharienne) et touche ainsi essentiellement les habitants de ces régions. Le diagnostic peut cependant être fait en France et dans les pays industrialisés chez des personnes ayant voyagé en zone tropicale. Parmi les cinq espèces qui peuvent être en cause, c’est P. falciparum qui est le plus préoccupant, étant le plus répandu et responsable de l’essentiel des formes graves, même si on en rapporte de plus en plus avec P. vivax, notamment chez l’enfant. Les autres espèces (P. ovale, malariae et knowlesi) sont plus rares. Dans les conditions de chaleur et d’humidité adéquates, le vecteur (anophèle femelle), d’activité nocturne, après s’être contaminé en prélevant du sang pour assurer sa reproduction par piqûre d’un malade porteur du parasite, va inoculer le parasite à une autre personne lors du repas sanguin suivant. Ces parasites gagnent rapidement le foie (phase hépatique, cliniquement muette, d’une durée d’une semaine pour P. falciparum) où ils se multiplient avant d’entamer, dans le sang, les cycles érythrocytaires leur permettant une nouvelle fois de se multiplier. C’est à partir de ces cycles érythrocytaires que des parasites jusque-là asexués vont se différencier en gamétocytes mâles et femelles qui seront prélevés par un autre moustique et pérenniseront la chaîne de transmission. P. vivax et P. ovale ont la possibilité de « s’endormir » dans les cellules hépatiques (hypnozoïtes) pour se réactiver plusieurs mois ou années plus tard, et entraîner un accès fébrile (reviviscence). Dans certains cas, et notamment lorsqu’un retard au diagnostic et donc au traitement permet une multiplication parasitaire importante, des formes graves se développent, faisant le lit de la mortalité. Différents organes peuvent être touchés, mais l’expression la plus fréquente est une encéphalite toxique secondaire à un ralentissement du flux sanguin dans les capillaires cérébraux par des phénomènes de cytoadhérence à la paroi vasculaire et de « rosettes » (amas d’hématies parasitées). Diagnostic clinique et paraclinique Diagnostic clinique Les signes cliniques apparaissent au moins une semaine après l’arrivée de l’enfant en zone d’endémie et les accès simples à P. falciparum surviennent en général dans les 2 mois qui suivent le retour, mais ils peuvent être plus tardifs. Dans notre expérience(3,4), environ 80 % des enfants présentent leurs premiers signes cliniques entre 7 et 16 jours après le retour en France et 20 % d’entre eux débutent la maladie dans le pays de séjour, entre 3 et 11 jours avant le retour en France. Les enfants ayant présenté un accès de paludisme sur le territoire français mettent en moyenne 3 jours pour consulter un médecin ; ce dernier n’évoque pas toujours le diagnostic et le délai moyen entre la consultation et le diagnostic parasitologique est en moyenne de 24 heures. Des chiffres semblables avaient été rapportés par M. Chalumeau en 2006(5). Quant aux enfants ayant présenté leurs premiers signes cliniques en zone d’endémie, le délai de recours aux soins est allongé (7 jours), alors que le délai entre la consultation et le diagnostic parasitologique reste le même (1 jour). La révision de la conférence de consensus sur le paludisme(6) notait en 2007 que « le retard du diagnostic est particulièrement préoccupant en pédiatrie ». Si le délai de consultation (3 jours après l’apparition d’une fièvre) ne paraît pas déraisonnable pour une pathologie banale (fièvre d’origine virale par exemple), il peut être dangereux dans un contexte de retour d’un pays d’endémie, puisque l’on sait que, chez l’enfant, moins de 24 heures peuvent s’écouler entre le début de la fièvre et l’apparition d’un neuropaludisme. Les parents de ces enfants (plus particulièrement les populations migrantes) doivent être sensibilisés à la nécessité de consulter très rapidement devant l’apparition d’une fièvre au retour d’un pays d’endémie palustre. Le délai entre la consultation et le diagnostic parasitologique peut lui aussi paraître acceptable (24 h) mais, dans le cas du paludisme, il est nécessaire de sensibiliser les médecins libéraux et les laboratoires de ville à la nécessité de raccourcir impérativement ce délai à quelques heures. Enfin, il paraît indispensable de souligner auprès des populations concernées l’importance de consulter, dès l’apparition des premiers signes, en zone d’endémie, même si le retour en France, trop souvent considéré comme la solution à tous les problèmes, est proche. Les signes principaux de l’accès palustre non compliqué sont la fièvre (93,5 à 97,2 %), les troubles digestifs (64 à 66 %) et les céphalées (32 à 40 %), réalisant le tableau, classique chez l’enfant, d’embarras gastrique fébrile. L’hépatosplénomégalie n’est retrouvée dans notre expérience que dans 9,6(3) à 12 %(4) des cas. La rareté d’une hépatosplénomégalie chez l’enfant impaludé a été soulignée par B. Lagardère(7), mais elle est rapportée chez 40 % de ces enfants dans une étude plus récente(8). Il est important de noter que la fièvre n’est pas toujours présente au moment où la température est prise par l’infirmière d’accueil et d’orientation et que, dans 16(3) à 47 %(4) des cas, les enfants impaludés présentent, outre la fièvre, une rhino-pharyngite, une angine ou une atteinte cutanée pouvant égarer le diagnostic. Cela souligne la nécessité, chez un enfant fébrile, de s’enquérir d’un éventuel retour d’un pays où sévit le paludisme. L’adage « toute fièvre au retour d’un pays d’endémie palustre doit être considérée comme un paludisme jusqu’à preuve du contraire » doit rester à l’esprit de tous les médecins si l’on veut éviter un retard diagnostique pouvant aboutir à un paludisme grave. Provoqué presque exclusivement par P. falciparum, le paludisme grave de l’enfant est rare en France (moins de 20 cas par an) et la létalité est faible (moins d’un décès par an). Les critères de gravité chez l’enfant retenus par l’OMS (tableau) n’ont pas été validés hors zone d’endémie. Le petit patient présente le plus souvent des troubles de la conscience d’apparition progressive ou brutale (somnolence, confusion, prostration, coma), des convulsions fréquentes et souvent inaugurales, une détresse respiratoire (témoin d’une acidose métabolique ou, plus rarement, d’un oedème pulmonaire) et une anémie grave. L’hypoglycémie est fréquente et doit être systématiquement prévenue par une perfusion glucosée ; elle peut être aggravée par la quinine intraveineuse. Une insuffisance rénale, le plus souvent fonctionnelle, est fréquemment présente. Lorsqu’une ponction lombaire est réalisée, le liquide céphalorachidien est normal. Sans traitement, l’évolution fatale est la règle en 2 ou 3 jours. Malgré une prise en charge adaptée en unité de soins intensifs, l’issue est fatale chez 10 à 30 % des patients et des séquelles neurologiques sont observées chez 10 % des survivants ; celles-ci vont disparaître dans la plupart des cas au bout de 6 mois, mais quelques enfants seront handicapés toute leur vie par une hémiplégie, un retard mental ou une hypertonie pyramidale. Diagnostic biologique Dans les formes simples de paludisme d’importation, les examens biologiques de l’enfant sont peu contributifs. L’anémie est modérée (valeurs moyennes de l’hémoglobine : 9,76 g/dl(3) ; 10,6 g/dl(4)). La thrombopénie n’est pas aussi fréquente que chez l’adulte (valeur moyenne des plaquettes : 195 000/mm3(3) ; dans une deuxième étude(4), 48 % des enfants avaient une thrombopénie > 150 000/mm3, avec une médiane de 142 000/mm3). Les valeurs de CRP sont très variables (moyenne : 70 mg/l ; extrêmes : 3-329 mg/l)(3). La preuve diagnostique est apportée par la présence d’hématozoaires sur le frottis sanguin et la goutte épaisse. Selon la révision de la Conférence de consensus, le résultat de ces examens doit être communiqué au praticien en moins de 2 heures. Le frottis sanguin consiste à étaler une goutte de sang sur lame et à colorer le frottis mince par le May-Grünwald-Giemsa. Cette technique permet le diagnostic d’espèce et la quantification de la parasitémie. Toutefois, c’est une technique peu sensible nécessitant, pour être positive, un minimum de 150 hématies parasitées par microlitre de sang et une lecture de 20 minutes de 2 x 200 champs par un opérateur, ou mieux, par deux opérateurs entraînés. La goutte épaisse utilise une technique de concentration permettant le diagnostic avec seulement 10 à 20 hématies parasitées par microlitre de sang. La parasitémie est estimée par le nombre de parasites comptés pour 500 leucocytes observés, mais l’identification des espèces est difficile en raison de la lyse des hématies. Dans notre expérience, 90 % des enfants impaludés sont infectés par P. falciparum. La parasitémie médiane est de 1,2 % pour P. faciparum, elle est nettement moins élevée pour les autres espèces (P. vivax 0,3 %, P. ovale 0,2 %, P. malariae 0,1 %). Les tests de diagnostic rapide mettent en évidence dans le sang des protéines spécifiques de Plasmodium sp. Peuvent être detectés l’antigène HRP-2 (histidine rich protein 2), la glycoprotéine spécifique de P. falciparum ou d’autres protéines non spécifiques de P. falciparum : lacticodéshydrogénase pan-malarique (pLDH) et aldolase. On peut aussi détecter des isomères de pLDH spécifiques d’espèce (P. falciparum et P. vivax). Ces tests ne doivent pas se substituer au diagnostic parasitologique. Leur sensibilité est supérieure à 95 % en ce qui concerne P. falciparum, elle est moins bonne pour les autres espèces. Des faux positifs (interaction avec le facteur rhumatoïde) et des faux négatifs (moins de 100 parasites par microlitre de sang, mutation/délétion du gène codant pour l’antigène HRP-2) ont été rapportés. Par ailleurs, il a été montré en zone d’endémie que l’antigène HRP-2 peut rester positif chez un enfant impaludé correctement traité plus de 30 jours après guérison(9). La QBC (quantitative buffy coat) test est une technique exploitant l’affinité spécifique de l’acridine orange envers les acides nucléiques, dont la lecture se fait à l’aide d’un microscope à immunofluorescence. Rapide et spécifique, ce test a un seuil de détection de l’ordre de 10 parasites par microlitre de sang. L’amplification génique permet de détecter de très faibles parasitémies, de quantifier l’ADN plasmodial et de rechercher des marqueurs nucléaires de résistance aux antipaludiques. Cette méthode onéreuse nécessite un circuit sécurisé et n’est pas réalisée en pratique courante. Traitement Formes graves Le paludisme grave de l’enfant doit être traité dès la suspicion diagnostique en unité de soins intensifs pédiatriques. Deux molécules peuvent être utilisées chez l’enfant. La quinine base est prescrite par voie intraveineuse à la posologie de 24 mg/kg/24 h à la seringue électrique, dans du sérum glucosé et sous surveillance électrocardiographique. Le surdosage de quinine, molécule cardiotoxique, est potentiellement mortel. C’est pourquoi la prescription de ce traitement doit faire l’objet d’une double vérification médicale et paramédicale. Un ECG est réalisé à H12 et H24. Une quininémie est prélevée à H24 et doit être comprise entre 30 et 37 μmol/l. La parasitémie est contrôlée à J3, J7 et J28. Dès que l’amélioration des signes neurologiques le permet, le relais est pris par voie orale, de préférence, dans notre expérience, par une cure complète d’atovaquone-proguanil (Malarone®). Les autres mesures de réanimation sont fonction des atteintes organiques associées et requièrent une prise en charge spécialisée. La doxycycline, au-delà de 8 ans, et la clindamycine, en-dessous de 8 ans, peuvent être associées à la quinine lorsqu’une sensibilité diminuée à ce médicament est rapportée. Par voie intraveineuse, l’artésunate est plus efficace et présente moins d’effets secondaires que la quinine chez l’adulte impaludé(10). Dans un essai réalisé par A.M. Dondorp et coll.(11) chez 5 425 enfants africains présentant un paludisme grave, les auteurs rapportent, dans le groupe traité par artésunate (n = 2 712), une mortalité (8,5 % vs 10,9 %) et une hypoglycémie après traitement (1,8 % vs 2,8 %) moindres que dans le groupe traité par quinine (n = 2 713). L’artésunate est donné à la dose de 2,4 mg/kg toutes les 12 heures à J1 puis une fois par jour, pendant au moins 24 h ou jusqu’à ce qu’un relais per os (artéméther-luméfantrine [Riamet®] en cure complète) puisse être pris. En France, on peut également utiliser un traitement par artéméther (Paluther®) en autorisation temporaire d’utilisation (ATU) à titre nominatif, par voie intramusculaire, à la dose de 1,6 mg/kg toutes les 12 heures à J1, puis 1,6 mg/kg une fois par jour de J2 à J5, ou jusqu’à ce qu’un relais per os puisse être pris selon les mêmes modalités que l’artésunate. Paludisme commun Plasmodium falciparum Le traitement de l’accès simple de l’enfant à P. falciparum fait l’objet de discussions. • La quinine per os (8 mg/kg/ 8 h de quinine-base) n’est en pratique pas utilisée chez l’enfant, en raison de son goût amer, de la longue durée (7 jours) du traitement et d’un possible cinchonisme (acouphènes, vertiges, troubles de la vision, nausées, céphalées, baisse de l’acuité auditive) pouvant aboutir à l’arrêt prématuré du traitement. • L’halofantrine (Halfan®) a longtemps été utilisée en première intention chez l’enfant, mais elle est actuellement moins prescrite. La posologie n’est pas précisée en dessous de 10 kg. Audessus de 10 kg, elle est administrée en trois prises de 8 mg/kg, chacune donnée à 6 h d’intervalle. La cardiotoxicité de cette molécule se limite dans l’immense majorité des cas chez l’enfant à un allongement de l’espace QT corrigé rapidement, réversible après traitement. Des manifestations plus graves ont été exceptionnellement rapportées chez des enfants présentant, la plupart du temps, des contre-indications à ce traitement(12). En revanche, une demi-vie brève et une absorption digestive variable sont probablement à l’origine de rechutes dans 10 à 20 % des cas. Les modalités d’une deuxième cure systématique à J8 ne sont pas clairement définies. Cardiotoxicité et risque de rechute ont conduit les experts de la révision de la Conférence de consensus à ne recommander l’halofantrine qu’en deuxième ligne. Toutefois, sa rapidité d’action et sa présentation particulièrement adaptée à l’enfant impaludé et souvent très nauséeux, sous forme d’un sirop au goût agréable, devraient permettre le maintien de cette molécule dans le traitement du paludisme commun chez l’enfant de moins de 6 ans, sous réserve d’une surveillance adaptée et s’il y a certitude de pouvoir contrôler ces enfants jusqu’à J30. • La méfloquine (Lariam®) est utilisée chez l’enfant de plus de 5 kg ou 3 mois, à la posologie de 24 mg/kg en deux à trois prises espacées de 6 à 12 heures selon l’âge. Avant 6 ans, les comprimés quadrisécables de 250 mg doivent être écrasés. Les effets secondaires les plus préoccupants sont les vomissements chez le petit enfant, parfois source d’échec thérapeutique, et qui justifient la prescription d’un antiémétique avant la prise de cette molécule. Des antécédents de convulsions ou de troubles neuro-psychiatriques sont des contre-indications à ce traitement. • L’atovaquone proguanil (Malarone®) en comprimés à 250 mg d’atovaquone est utilisée chez l’enfant à partir de 11 kg (1 cp de 11 à 20 kg ; 2 cps de 21 à 30 kg ; 3 cps de 31 à 40 kg ; 4 cps au-delà de 40 kg). En dessous de ce poids, on recommande dans les pays anglo-saxons – et en France, hors AMM – une prise quotidienne pendant 3 jours de deux comprimés pédiatriques (62,5 mg d’atovaquone par comprimé) pour un poids de 5 à 8 kg et de trois comprimés pédiatriques pour un poids de 8 à 10 kg. Ces comprimés doivent être écrasés chez l’enfant de moins de 6 ans – ils ont alors un goût très désagréable – et donnés à la même heure, 3 fois à 24 h d’intervalle, 30 minutes après un repas lacté contenant environ 20 g de graisses. Les vomissements peuvent, dans environ 15 % des cas, conduire à un changement de molécule(4). • L’artéméther luméfantrine (Riamet®) dispose en France d’une AMM à partir d’un poids de 5 kg, mais on manque de données chez l’enfant dans le cadre du paludisme d’importation. Avant 6 ans, les comprimés doivent être écrasés ou dissous dans de l’eau et les prises sont administrées avec un repas riche en graisses. Les effets secondaires rapportés en zone d’endémie sont la toux, une anémie et des troubles digestifs. Plasmodium ovale, P. vivax, P. malariae Le traitement de première intention est la chloroquine (Nivaquine®) à la posologie de 10 mg/kg à H1, 5 mg/kg à H6 puis 5 mg/kg 24 et 48 heures après cette deuxième prise. Au-delà de deux accès de reviviscence à P. ovale ou P. vivax, un traitement par primaquine est disponible (300 μg/kg/j pendant 14 j) sous ATU nominative. Ce médicament est contre-indiqué en cas de déficit en glucose 6 phosphate déshydrogénase, dont le dépistage est nécessaire avant d’envisager ce traitement. Quelques souches de P. vivax résistantes à la chloroquine en Asie du Sud-Est et en Amazonie nécessitent le recours à l’une des molécules efficaces contre P. falciparum. Suivi du traitement Il est vivement recommandé par l’OMS et par l’InVS de réaliser un contrôle clinique et parasitologique (frottis-goutte épaisse, à l’exclusion des tests de diagnostic rapide) 72 h et un mois après le traitement (et à J7 en cas de positivité à J3) afin de dépister un échec thérapeutique précoce ou tardif. Les familles doivent être, par ailleurs, informées du risque de rechute dans les semaines qui suivent un paludisme traité et de la nécessité de reconsulter rapidement en cas de fièvre. Prophylaxie Prophylaxie d’exposition Ce type de prophylaxie a une importance primordiale chez l’enfant. La femelle anophèle ne piquant qu’après le coucher et avant le lever du soleil, la moustiquaire imprégnée de pyréthrinoïdes constitue probablement la meilleure protection mécanique. Encore faut-il que l’enfant soit effectivement sous sa moustiquaire aux heures mentionnées. Par ailleurs, la moustiquaire doit être en bon état, correctement bordée et loin du corps de l’enfant. Le soir, à l’intérieur des maisons, des insecticides peuvent être utilisés (diffuseurs électriques ou flacons pressurisés) et, à l’extérieur, on peut disposer des tortillons fumigènes. Le port de vêtements longs et imprégnés de pyréthrinoïdes constitue une bonne protection, difficile à faire accepter par les enfants, souvent en short et sans socquettes. La climatisation diminue l’agressivité des moustiques mais ne supprime pas le risque d’être piqué ; il faut en outre se méfier des toilettes, rarement climatisées, où le risque de se faire piquer par une anophèle la nuit n’est pas négligeable. Les répulsifs cutanés, dans un environnement où les moustiques sont nombreux, empêchent au mieux 85 % des piqûres d’anophèles. Leur durée d’action, limitée par la transpiration, excède rarement 3 heures. La concentration des différents répulsifs autorisée chez l’enfant en fonction de son âge est précisée chaque année dans le Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire. Chimioprophylaxie Aucun médicament ne prévient le paludisme avec une sécurité absolue. • Dans les rares pays du groupe 1 de résistance de P. falciparum à la chloroquine (Amérique centrale, Iran, Irak…), cette molécule est utilisée à la posologie de 1,5 mg/kg/j une fois par jour, en commençant le traitement la veille ou le jour du départ et en le poursuivant 4 semaines après le départ de la zone d’endémie. En dessous de 6 ans, on prescrit, plutôt que des comprimés à 100 mg que le petit enfant ne peut avaler, du sirop (25 mg/ 5 ml) dont l’amertume peut être atténuée par de la confiture ou du miel. Le sirop, une fois le flacon ouvert, ne se conserve guère plus de 15 jours et le flacon doit impérativement être tenu hors de la portée des enfants en raison d’un risque d’intoxication sévère. La chloroquine est bien supportée en dehors de rares cas de prurit chez les enfants de race noire. • Dans les pays du groupe 2 (Madagascar, Inde, Sri Lanka…), le proguanil (Paludrine®) est utilisé en association à la chloroquine selon les mêmes modalités à la dose moyenne de 3 mg/kg/j. Les comprimés de 100 mg sécables doivent être écrasés chez l’enfant de moins de 6 ans. • Dans les pays du groupe 3, trois molécules peuvent être utilisées : – la méfloquine (Lariam®), indiquée sans limitation de durée de séjour à partir de 15 kg, doit être prise une fois par semaine pendant le séjour et 3 semaines après le départ de la zone d’endémie, à la dose moyenne de 5 mg/kg/ semaine. Convulsions et antécédents neuro-psychiatriques sont des contre-indications au traitement et un test de tolérance est recommandé, en absorbant une prise 10 jours puis 3 jours avant le départ ; – l’atovaquone-proguanil (Malarone®) est indiquée à partir de 11 kg en comprimés dosés à 62,5 mg d’atovaquone à la posologie de 1cp/10 kg/j jusqu’à 40 kg, avec une boisson lactée à la même heure chaque jour en pays d’endémie (en commençant le jour du départ ou la veille) et une semaine après le retour. Les comprimés doivent être écrasés chez les enfants qui ne peuvent les avaler (en général en dessous de 6 ans) ; la poudre obtenue a un goût très désagréable et doit être absorbée avec de la pâte à tartiner chocolatée ou un yaourt très sucré ; – la doxycycline (Doxypalu® ou Granudoxy®) est contre-indiquée chez l’enfant en dessous de 8 ans en France, de 12 ans en Grande- Bretagne, en raison d’un risque de jaunissement définitif des dents. La posologie est de 50 mg au-dessous de 40 kg et 100 mg au-dessus de ce poids, une fois par jour dès le jour du départ (ou la veille) et pendant 4 semaines après le retour de la zone d’endémie. On conseille une prise le soir pendant le repas pour limiter les effets secondaires (douleurs abdominales et photosensibilisation). • Chez l’enfant de moins de 10 kg et qui, la plupart du temps, ne marche pas encore, il convient de renforcer les mesures anti-vectorielles, en particulier la moustiquaire imprégnée, plus facile à imposer dès le coucher du soleil à un nourrisson qu’à un enfant plus grand. La prescription hors AMM de méfloquine (proposée aux États-Unis et en Grande-Bretagne dès 6 kg) ou d’atovaquone-proguanil (proposée aux États-Unis à la dose de 1/2 comprimé enfant de 5 à 8 kg et de 3/4 de comprimé enfant de 8 à 10 kg) peut être proposée, même si la réalisation pratique de cette prescription est difficile chez des petits nourrissons, en particulier lors de séjours prolongés. En cas d’allaitement d’un nourrisson, il conviendra également de vérifier que la mère ne prend pas de chimioprophylaxie contre-indiquée pour son enfant, en particulier de la doxycycline. • Durant des séjours excédant 6 mois en zone d’endémie, on recommande aux parents de prendre contact localement avec un médecin ou un organisme qualifiés pour évaluer la pertinence d’une prophylaxie prolongée ; en zone sahélienne, on privilégiera une chimioprophylaxie saisonnière couvrant la saison des pluies. • Enfin, en cas de traitement curatif d’un enfant impaludé au retour d’une zone d’endémie, il n’est pas utile de reprendre la chimioprophylaxie après ce traitement.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :