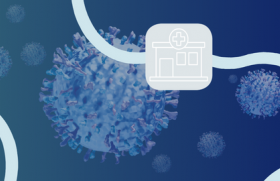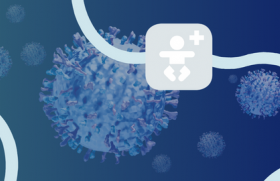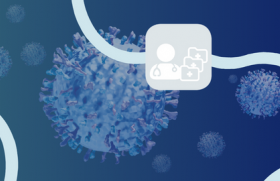Publié le 30 avr 2025Lecture 4 min
Impact de la qualité de l’air sur la croissance pulmonaire et le déclin de la fonction respiratoire : une évidence scientifique
Hélène JOUBERT, d’après la session A24 : Dis-moi où tu vis et je te dirai comment tu respires. Influence de la qualité de l’air sur la croissance pulmonaire et le déclin de la fonction respiratoire de I. Annesi-Maesano (Montpellier)

Près de 99 % de la population mondiale vit dans des zones où les niveaux de qualité de l’air recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne sont pas respectés. Or, les effets de la pollution atmosphérique sur la croissance pulmonaire sont désormais bien documentés, notamment en ce qui concerne les particules fines PM2,5.
Une métaanalyse récente a compilé les preuves scientifiques indiscutables sur les effets délétères des expositions aux PM2,5 sur la fonction pulmonaire des enfants(1). Pour chaque augmentation de 10 g/m3 , la capacité vitale forcée (CVF), le volume expiratoire forcé en une seconde (VEF1) et le débit expiratoire de pointe (DEP) diminuent respectivement de 21,39 ml, 25,66 ml et 1,76 l/min(1). Le sexe, l’indice de masse corporelle (IMC), l’humidité relative, la température et le niveau moyen d’exposition aux PM2,5 modifient la relation entre l’exposition à court terme aux PM2,5 et la fonction pulmonaire. Les concentrations de PM2,5 dans les études d’exposition à long terme confirment pour leur part que pour chaque augmentation de 10 µg/m3, le VEF1, la CVF et le DEP diminuent respectivement de 61 ml, 54,47 ml et 10,02 ml/min. Une autre étude de référence a constaté un impact plus marqué sur la taille des voies respiratoires que sur la réduction du volume pulmonaire(2). « L’exposition chronique aux particules fines (PM2,5, PM10), aux oxydes d’azote (NO2) et à l’ozone (O3) limite le développement des volumes pulmonaires chez l’enfant, comme l’ont montré plusieurs études longitudinales, assure Isabella Annesi-Maesano (Institut Desbrest d’épidémiologie et de santé publique [IDESP], Inserm et Université de Montpellier). Une exposition précoce aux polluants atmosphériques est également associée à une prévalence plus élevée de l’asthme, des infections respiratoires et de l’hyperréactivité bronchique. À cela s’ajoute le fait qu’une croissance pulmonaire altérée durant l’enfance a des conséquences à long terme, en réduisant la capacité respiratoire, le déclin de la fonction respiratoire chez l’adulte et les personnes âgées. Cela augmente le risque de pathologies respiratoires chroniques, dont la BPCO. Il est admis que les polluants sont responsables d’excès de mortalité toutes causes, dont la baisse de VEMS (volume expiratoire maximal en une seconde) est un prédicteur. Il est également démontré aujourd’hui que l’impact d’une exposition prolongée sur la fonction pulmonaire est plus important que celui d’une exposition de courte durée. »
L’influence de la génétique et l’épigénétique
Ces effets sur la fonction respiratoire sont médiés par la génétique et l’épigénétique. Plusieurs facteurs génétiques influençant la sensibilité à la pollution de l’air ont été identifiés, dont les gènes liés au stress oxydatif. Précisément, les polymorphismes des gènes GSTP1, NQO1 et GSTM1 modulent la capacité des cellules pulmonaires à neutraliser les radicaux libres générés par les polluants atmosphériques (particules fines, oxy des d’azote et ozone). Les individus porteurs d’une délétion du gène GSTM1 présentent aussi une réponse inflammatoire exacerbée et un risque accru d’altération de la fonction pulmonaire. Concernant les gènes de l’inflammation, les variations dans les gènes TNF-α, IL-6 et IL-10 influencent la réponse inflammatoire aux particules fines et aux gaz irritants, augmentant ainsi le risque de maladies respiratoires chroniques. Une surexpression de TNF-α est notamment associée à une diminution accélérée du VEMS. Quant aux gènes de la croissance pulmonaire et du remodelage bronchique, il est bien montré que les mutations dans les gènes VEGF, impliqués dans la croissance vasculaire, et ADAM33, associé au remodelage bronchique, influencent la régénération pulmonaire. « Ces altérations pourraient expliquer pourquoi certains enfants exposés à la pollution développent des déficits ventilatoires durables », explique I. Annesi-Maesano. Les facteurs épigénétiques influençant la sensibilité à la pollution de l’air sont également de mieux en mieux connus. La méthylation des promoteurs des gènes impliqués dans l’inflammation et le stress oxydatif est ainsi observée après une exposition prolongée aux polluants atmosphériques. Des niveaux élevés d’oxydes d’azote et de PM2,5 sont notamment associés à une hyperméthylation du gène FOXP3, impliqué dans la régulation immunitaire, ce qui pourrait aggraver les réactions allergiques et l’asthme. » Les polluants atmosphériques modifient également l’expression des histones et des microARN (miRNA), régulateurs clés de l’inflammation et de la régénération pulmonaire. Certains comme miR-21, miR-146a, etc., voient leur expression altérée sous l’effet de la pollution, influençant ainsi les processus de réparation et de réponse inflammatoire des tissus pulmonaires.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :